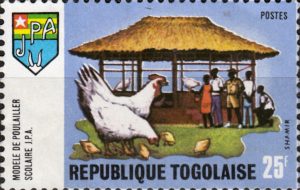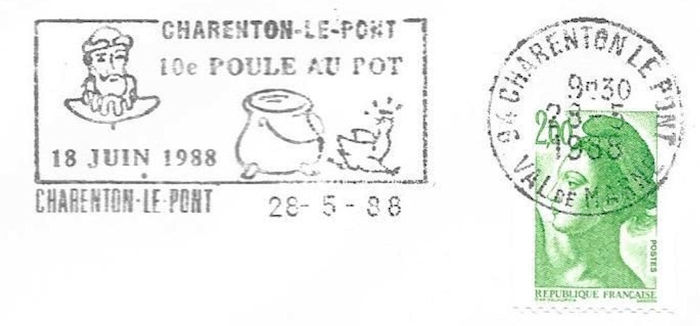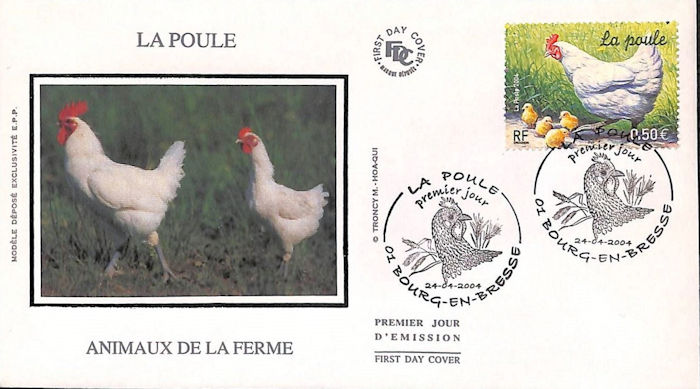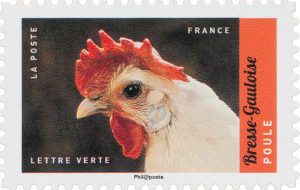Bien que l’agro-industrie se soit intéressée tardivement à la poule, elle demeure cependant l’animal domestique le plus manipulé artificiellement par l’homme. Nous connaissons donc parfaitement sa morphologie, son anatomie, son mode de vie, son alimentation, et nous en maîtrisons les méthodes d’élevage, de reproduction et de sélection. Malgré cela, l’histoire de l’espèce poule reste émaillée de points obscurs mêmes si certains d’entre eux furent éclaircis ces dernières années suite à la publication dans la revue Nature, fin 2004, du génome décodé de la poule.
L’ère des dinosaures s’est étendue de -230 à -65 millions d’années. Les paléontologues s’accordent à dire que c’est au cours de cette période que sont d’abord apparus de petits dinosaures à plumes (vers -150 millions d’années, à la fin du Jurassique), qui ont évolué petit à petit vers leurs formes d’oiseaux modernes : adaptation du squelette et allégement des os, passage du vol plané au vol battu, apparition du bec et disparition des dents (vers -80 millions d’années, à la fin du Crétacé). Cette adaptation permet aux oiseaux de survivre à la 5e extinction de masse qui voit s’éteindre les dinosaures non aviaires ainsi que de très nombreuses autres espèces du règne animal. L’oiseau peut alors poursuivre son évolution naturelle jusqu’à sa rencontre avec l’homme.
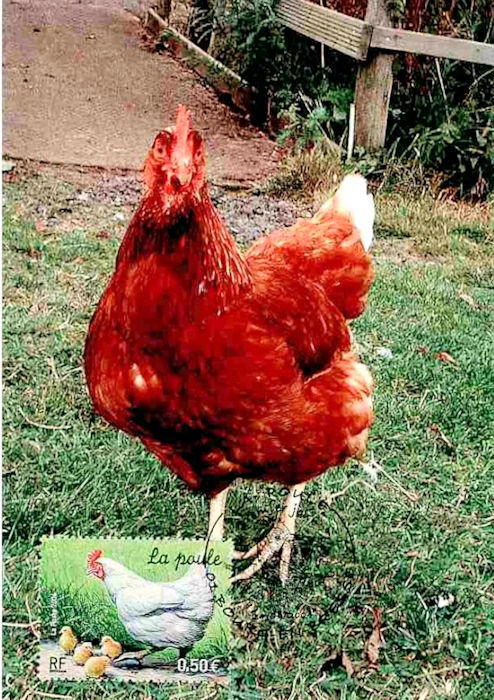
Il y a environ 10 000 ans, les premiers hommes se sédentarisent et passent du statut de chasseurs-cueilleurs à celui de producteurs (agriculteurs-éleveurs). On estime la période de domestication de la poule entre -8000 et -6000 ans avant notre ère en Asie. Il est certain qu’à cette époque les poules pondent entre 5 et 20 œufs par année, comme des oiseaux sauvages. Cette performance médiocre n’est donc probablement pas à l’origine de l’élevage des gallinacés. Selon les zones géographiques où l’homme s’est implanté, chiens, vaches, chèvres, moutons, porcs sont déjà domestiqués. La quête de nourriture n’est donc pas la priorité absolue surtout en regard de la taille de l’animal (300 à 700 g pour un Bankiva). Le coq ne servait-il alors que de réveil matin ? Il y a fort à parier que c’est en partie l’instinct combatif de cet oiseau qui a poussé l’homme à l’introduire dans ses villages comme distraction à travers les combats de coqs.
Bien que l’agro-industrie se soit intéressée tardivement à la poule, elle demeure cependant l’animal domestique le plus manipulé artificiellement par l’homme. Nous connaissons donc parfaitement sa morphologie, son anatomie, son mode de vie, son alimentation, et nous en maîtrisons les méthodes d’élevage, de reproduction et de sélection. Malgré cela, l’histoire de l’espèce poule reste émaillée de points obscurs mêmes si certains d’entre eux furent éclaircis ces dernières années suite à la publication dans la revue Nature, fin 2004, du génome décodé de la poule.
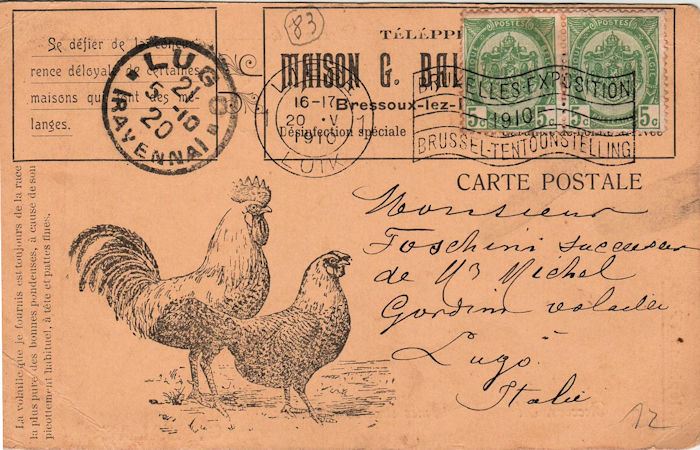
L’ère des dinosaures s’est étendue de -230 à -65 millions d’années. Les paléontologues s’accordent à dire que c’est au cours de cette période que sont d’abord apparus de petits dinosaures à plumes (vers -150 millions d’années, à la fin du Jurassique), qui ont évolué petit à petit vers leurs formes d’oiseaux modernes : adaptation du squelette et allégement des os, passage du vol plané au vol battu, apparition du bec et disparition des dents (vers -80 millions d’années, à la fin du Crétacé). Cette adaptation permet aux oiseaux de survivre à la 5e extinction de masse qui voit s’éteindre les dinosaures non aviaires ainsi que de très nombreuses autres espèces du règne animal. L’oiseau peut alors poursuivre son évolution naturelle jusqu’à sa rencontre avec l’homme.
Il y a environ 10 000 ans, les premiers hommes se sédentarisent et passent du statut de chasseurs-cueilleurs à celui de producteurs (agriculteurs-éleveurs). On estime la période de domestication de la poule entre -8000 et -6000 ans avant notre ère en Asie. Il est certain qu’à cette époque les poules pondent entre 5 et 20 œufs par année, comme des oiseaux sauvages. Cette performance médiocre n’est donc probablement pas à l’origine de l’élevage des gallinacés. Selon les zones géographiques où l’homme s’est implanté, chiens, vaches, chèvres, moutons, porcs sont déjà domestiqués. La quête de nourriture n’est donc pas la priorité absolue surtout en regard de la taille de l’animal (300 à 700 g pour un Bankiva). Le coq ne servait-il alors que de réveil matin ? Il y a fort à parier que c’est en partie l’instinct combatif de cet oiseau qui a poussé l’homme à l’introduire dans ses villages comme distraction à travers les combats de coqs.
On peut aussi supposer que le plumage très coloré des mâles servait à confectionner parures et décorations. Plus tard, grâce à leur petite taille, les poules permettent aux caravanes de nomades ainsi qu’aux navigateurs de voyager avec une réserve de nourriture facile à transporter. La poule se serait répandue à travers le monde par cet intermédiaire et serait arrivée en Europe aux alentour de -700 av. J.-C. par le bassin méditerranéen.
De nos jours, il existe quatre espèces de poules primitives encore présentes à l’état sauvage ayant chacune leur zone géographique en Asie : le coq doré, le coq de Sonnerat, le coq de Lafayette et le coq vert de Java. On a longtemps cru que seul le coq Bankiva, une sous espèce de coqs dorés, était à l’origine de toutes nos poules domestiques, mais on sait depuis 2008 qu’une partie du patrimoine génétique de Gallus Gallus Domesticus provient du coq de Sonnerat et vraisemblablement d’autres espèces ou sous-espèces aujourd’hui disparues.
Les couleurs arborées par les coqs et poules sauvages Bankiva forment un coloris appelé « doré ». Le mâle possède un plumage très coloré visant à séduire ses compagnes, alors que la femelle se pare d’une robe beaucoup plus discrète dédiée uniquement au camouflage. À partir de ce coloris « doré », il est génétiquement possible d’obtenir toutes les nuances de plumage que nous connaissons. L’évolution naturelle peut aboutir à des changements de couleur en fonctions de critères environnementaux : les Lagopèdes (oiseaux galliformes) possèdent par exemple un plumage mimétique, blanc en hiver et brun-roux en été. Cependant, nos poules n’ont aucune raison de changer de couleur, et le coloris dominant devrait donc rester proche de celui d’origine. Or, des études menées sur les races européennes très anciennes montrent un détail curieux : elles sont majoritairement de couleur noire !
On sait que les Romains ont célébré la victoire des guerres puniques (-264 à -146 av. J.-C.) au nom de la déesse Cybèle, représentée par une pierre noire, en lui sacrifiant des coqs de la même couleur. On suppose que les peuples conquis lors de la guerre des Gaules (-58 à -50 av. J.-C.) ont jugé les poules noires supérieures aux autres et ont perpétué une sélection sur ce coloris. Cette hypothèse est renforcée par le fait qu’on ne retrouve pas cette dominance noire dans les régions non conquises par les Romains.
À l’époque féodale, les paysans livrent souvent des poules à leurs seigneurs à titre d’impôt, et il se trouve que ces derniers réclament principalement des individus noirs. Il s’agit peut-être d’une marque de puissance et de supériorité affichée par les nobles pour qui il est bon ton de déguster des gelines noires, au même titre que manger du pain blanc.
Au début du XIXe siècle, l’homme maîtrise la sélection de ses volailles et malgré la dominance de la couleur noire, chaque région possède plus ou moins une race locale adaptée à son milieu géographique.
À partir de 1840, l’ouverture des ports orientaux au commerce international permet l’importation de nouvelles poules asiatiques de grand gabarit (Brahma, Cochinchinoise, Langshan, Combattant malais). Ces nouvelles volailles sont immédiatement mises à profit par de nombreux croisements avec des poules locales afin d’en augmenter la productivité. Ces améliorations, ainsi que la sélection artificielle menée un peu partout dans le monde, participent alors à la création de nombreuses races. En 1849, la passion de la reine Victoria pour les poules de collection relance encore l’intérêt (surtout des nobles) pour ces oiseaux, c’est pourquoi une grande partie des races que nous connaissons aujourd’hui a été conçue au cours de la seconde moitié de ce siècle. Dans le même temps, les premières expositions avicoles sont instaurées, ainsi que les premiers standards. En France, la Société Nationale d’Aviculture est fondée en 1891.
On peut considérer le début du XXe siècle comme l’âge d’or des poules de race, mais très rapidement surviennent deux événements qui vont radicalement changer l’aviculture. L’application des lois de Mendel par les chercheurs américains leur permet le développement scientifique de races à haut rendement (Wyandotte, Rhode-Island, Leghorn…) qui viennent inonder le Vieux Continent. Une majorité d’éleveurs délaissent alors leur race locale et choisissent des animaux plus productifs (de 160 à 200 œufs/an) laissant miroiter des gains encore jamais atteints. Les Américains en profitent pour introduire des méthodes d’élevage beaucoup plus intensives, prémices de l’élevage moderne.
Voir aussi cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=CCYsauRJmGE
Sources : Permaculturedesign, YouTube.