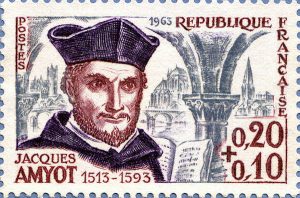Etienne Méhul, compositeur.
Etienne Méhul est né à Givet, le 22 juin 1763, mort à Paris le 18 octobre 1817.
Son père, Jean-François, est maître d’hôtel du comte de Montmorency, puis à la mort de ce dernier, il est négociant en vins.
Méhul prend ses premières leçons de musique avec un organiste de Givet, et à l’âge de dix ans, il devient l’organiste du couvent Franciscain des Recollectines de Givet. En 1775, il prend occasionnellement des leçons, y compris de composition, avec un moine, Wilhelm Hanser, à l’abbaye de Laval-Dieu, près de Givet, en 1778, il est son suppléant à l’orgue de l’abbaye.